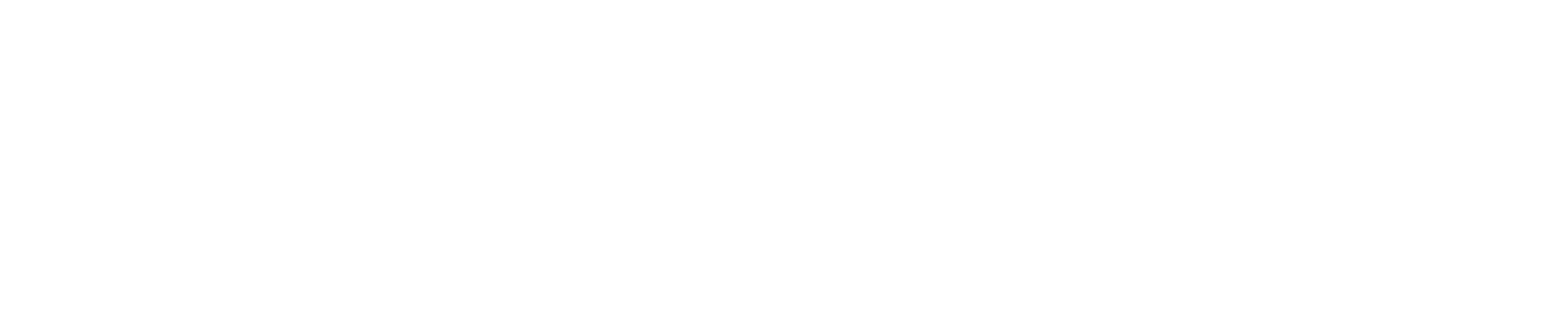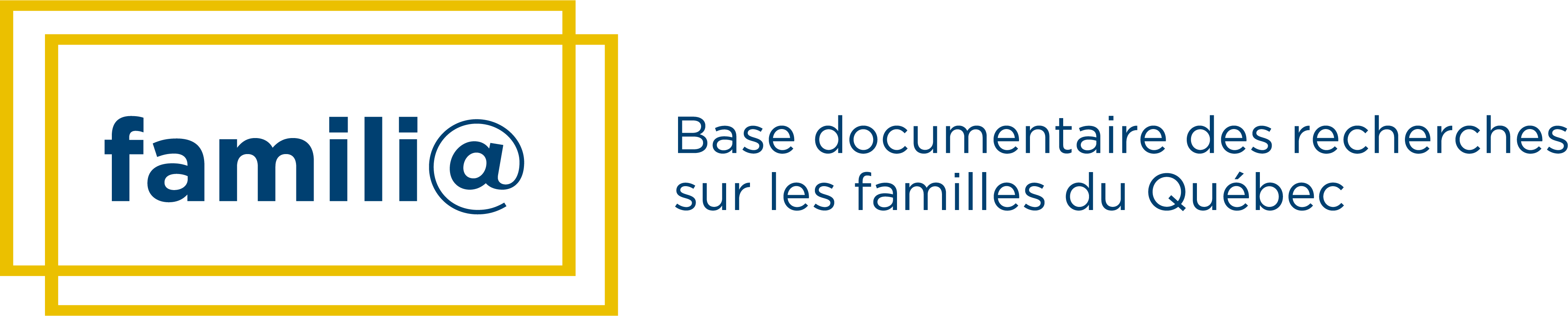Entre précarité d’emploi, statuts incertains et repères culturels différents, concilier insertion à la société d’accueil et projet de maternité devient un véritable défi. Par exemple, les parcours des femmes immigrantes en provenance de pays d’Asie du Sud sont façonnés par des enjeux souvent méconnus. Mais alors, comment la migration redéfinit-elle leurs aspirations familiales? Quels facteurs influencent leurs décisions en lien avec la famille? En se heurtant aux barrières liées à la race, au genre et à leur situation socioéconomique, elles font face à une réalité bien loin de l’idéal de libération souvent associé à leur projet migratoire.
Pour explorer ces questions, une stagiaire postdoctorale de l’Université de Sherbrooke se penche sur le vécu de femmes sud-asiatiques, récemment immigrées à Montréal. Pour ce faire, elle rencontre 39 femmes, âgées entre 21 et 42 ans, originaires de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka, installées à Montréal depuis 2 à 10 ans. Toutes sont mariées et au foyer, sans aucune source de revenus propre, et avaient entre 1 et 3 enfants ou étaient enceintes à leur arrivée. L’étude se déroule en trois temps : entrevues biographiques orientées autour de la périnatalité; suivi au jour le jour; et participation active de la chercheuse aux activités quotidiennes dans le quartier où se déroule l’étude. Un constat? Face aux défis liés à l’immigration, elles doivent souvent repenser leur désir d’enfant et leurs projets familiaux.
Repenser la maternité loin de chez soi
Le parcours migratoire est un processus difficile à vivre : isolement, démarches laborieuses liées à un statut migratoire parfois incertain, intégration professionnelle ardue… Pour plusieurs femmes, les défis rencontrés les amènent à reconsidérer leurs projets familiaux, et à adopter des stratégies d’adaptation complexes qui reflètent la situation particulière de chacune. Parmi les participantes, plusieurs sont amenées à freiner leur désir d’enfant, ajustant ainsi leurs projets familiaux à leur nouvelle réalité. Pourquoi? En raison du contexte social du pays d’accueil, précisément celui de la région montréalaise.
L’une des principales explications réside dans l’appauvrissement du réseau d’entraide féminine inhérent au processus migratoire. En effet, le désir d’enfant s’accompagne souvent d’un besoin de soutien familial, une attente ancrée dans les traditions de leur culture d’origine. Même si ces femmes conservent des liens transnationaux avec leur famille restée au pays, ces relations à distance ne peuvent compenser le soutien régulier autrefois assuré. Face à cette absence de réseau local, elles doivent alors réévaluer leur mode de vie. Ainsi, pour mieux gérer leur réalité de tous les jours – notamment les tâches domestiques et les soins aux enfants qui sont déjà nés – elles choisissent de ne pas agrandir davantage leur famille.
« Parce que j’ai un gros soutien là-bas […]. Ici, personne ne s’en soucie, tu sais. Je suis seule, je n’ai personne qui me soutient, c’est pour ça que je ne veux pas de bébé. » – Vishani, originaire du Sri Lanka
Le poids du statut migratoire sur le désir d’enfant
Le statut migratoire joue un rôle central dans les décisions reproductives des femmes immigrantes. Il influence grandement la manière dont elles conçoivent leur rapport à la maternité et redéfinissent leur famille. Pour celles qui détiennent un statut de réfugiée, l’isolement social et le sentiment de solitude associés à leur situation sont renforcés par l’incapacité de maintenir leurs habitudes et traditions. Ce faisant, la famille devient un repère essentiel pour déjouer ces ruptures sociales, recréer des liens, préserver leur culture et reconstruire leur place dans la société d’accueil.
« Au Canada, j’ai besoin de plus d’enfants. Parce que tu sais […] on a tellement de coutumes, mais là on est seul, toutes les coutumes nous manquent. » – Malika, originaire d’Inde
Cette caractéristique du projet de maternité comme rôle clé dans la trajectoire migratoire est également constatable pour celles au statut plus précaire. Dans le cas des femmes en attente de régularisation de statut, la grossesse et la naissance peuvent être perçues comme un moyen d’assurer une certaine sécurité juridique et sociale. En donnant naissance au Canada, des femmes comme Padmalay cherchent à renforcer leurs attaches avec le pays et ainsi accéder aux services de santé, scolariser leurs enfants ou espérer une régularisation de leur propre statut.
Les décisions reproductives des femmes migrantes sont également influencées par leur capacité à agir dans ce contexte qui est le leur. Cette réalité peut conduire à des choix difficiles et parfois contradictoires avec leurs désirs personnels. Ainsi, Veena, en raison de la précarité de son statut, est allée jusqu’à interrompre sa grossesse malgré son envie d’avoir un enfant.
« Pas maintenant. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver à notre vie, alors pourquoi suis-je à nouveau enceinte ? » – Veena, 31 ans, originaire de l’Inde
En somme, les femmes récemment immigrées se voient plutôt développer une conception unique de la famille, et donc du projet de maternité, bien à part et propre à leur situation légale et administrative.
La maternité comme réponse à l’exclusion professionnelle
Pour de nombreuses femmes immigrantes hautement scolarisées, l’insertion professionnelle est la raison principale de leur projet migratoire. Cependant, une fois arrivées dans le pays d’accueil, plusieurs obstacles rencontrés sur le marché du travail bouleversent leurs aspirations et influencent de nouveau leurs décisions en matière de maternité. En première ligne? La barrière de la langue et la non-reconnaissance de leurs diplômes.
Les conséquences de ces difficultés professionnelles s’étendent jusqu’à l’accès au logement et aux conditions de vie. Le coût élevé de la vie, le manque de logements à Montréal, combinés à la précarité d’emploi, deviennent aussi un frein au désir d’enfant.
À cette exclusion économique peut également s’ajouter une exclusion sociale significative, où ces femmes se sentent dévalorisées malgré leur haut niveau de formation. Certaines participantes ont l’impression de ne pas être reconnues à leur juste valeur, ce qui engendre frustration et sentiment d’injustice.
Cette rupture entre l’identité professionnelle perçue et la reconnaissance sociale réelle affecte leur sentiment d’appartenance au pays d’accueil. Dès lors, certaines reconsidèrent la maternité non seulement comme un choix personnel, mais comme une stratégie identitaire et sociale. En l’absence d’une reconnaissance professionnelle valorisante, la maternité devient une alternative leur permettant de redonner du sens à leur vie et d’acquérir une visibilité sociale. À défaut de pouvoir s’épanouir dans leur travail, elles trouvent dans le rôle de mère une manière de s’affirmer et d’accroître leur importance dans le pays d’accueil.
« Avant [la grossesse] elle se mettait parfois en colère. La plupart du temps, elle se mettait en colère, je me mettais en colère, je devenais dépressif, mais maintenant, 99 % du temps, nous sommes pour la plupart heureux. » – Mari de Mizha, originaire du Pakistan
Équilibre conjugal et maternité : le cas des femmes parrainant leur conjoint
L’étude met également en lumière la situation particulière des femmes immigrantes qui parrainent leur conjoint. C’est notamment le cas de Vishani, dont le mari est arrivé seul, sans sa famille pour l’accompagner. Contrairement aux configurations traditionnelles du pays d’origine où l’homme est généralement celui qui accueille sa conjointe au sein de sa famille, dans ce type de dynamique de parrainage, les fonctions sont inversées. La structure familiale traditionnelle s’en trouve bouleversée, tout comme le projet de maternité. Le mari ne pouvant pas fournir un réseau d’entraide familial adéquat, il se retrouve en perte de pouvoir face à ses responsabilités.
Pour rééquilibrer cette dynamique inhabituelle, le couple doit s’adapter. Toutefois, comme le principal soutien familial disponible est uniquement du côté de l’épouse, elle est contrainte de choisir entre son projet de maternité et la stabilité de son couple. Pour éviter de le perturber, elle ajuste ses attentes et revoit le recours au soutien familial disponible à la baisse. Dans ces circonstances, il n’est pas rare de voir des femmes reporter, voire abandonner, leur projet d’agrandir leur famille afin de conjuguer les attentes liées aux rôles traditionnels et la réalité du pays d’accueil.
L’impact majeur des défis migratoires sur les projets de maternité
L’expérience du désir d’enfant et de la maternité chez les femmes sud-asiatiques participant à l’étude révèle des défis majeurs liés au statut migratoire, à l’isolement social et aux perspectives professionnelles limitées. Contrairement à l’idée préconçue d’une immigration libératrice, ces femmes doivent composer avec des contraintes diverses qui influencent leur projet de maternité. Par conséquent, plutôt que de rompre avec les normes traditionnelles, elles les adaptent à leur nouvelle réalité, en fonction des défis rencontrés dans le pays d’accueil. Leurs trajectoires illustrent ainsi un processus d’ajustement et de redéfinition des rôles familiaux, influencé autant par leur expérience passée que par les conditions présentes.
Si la maternité est parfois perçue comme un choix stratégique, pour certaines femmes, elle reste une réponse aux barrières systémiques, notamment l’exclusion professionnelle. Les difficultés rencontrées les poussent à se valoriser à travers leur rôle potentiel de mère. Ce maintien dans la sphère domestique renforce ainsi les rôles traditionnels de genre. Bien que l’étude précise que leurs capacités d’adaptation soient le résultat de leur pouvoir d’agir, elle avance également que leurs choix contribuent souvent à les replacer dans l’espace privé du foyer. Il est donc essentiel d’examiner comment les normes familiales évoluent au cours du parcours migratoire et influencent les décisions reproductives et l’autonomie de ces femmes.