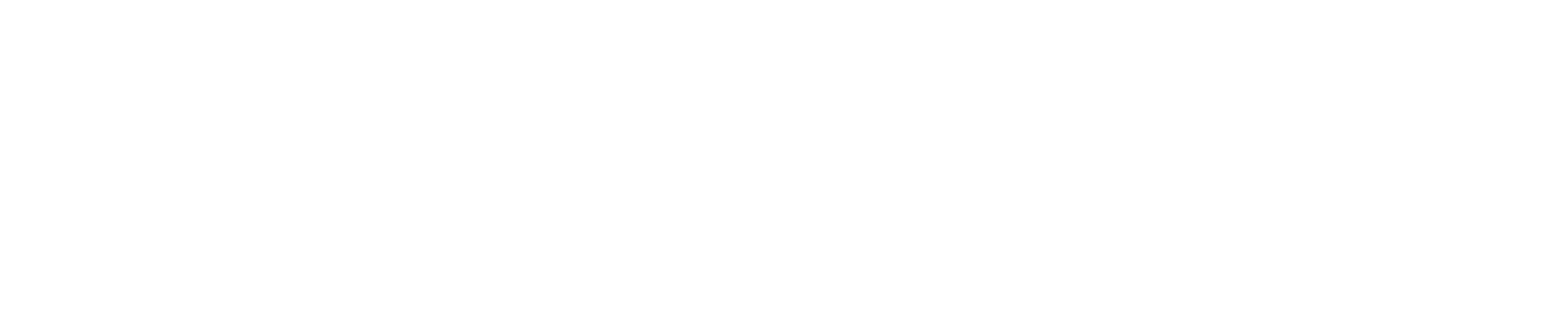Enfants orphelins, changement de conjoint, famille d’accueil… Nombreuses sont les raisons qui peuvent mener au projet d’adopter. Les lois qui entourent l’adoption sont d’ailleurs le reflet de la façon dont on conçoit l’appartenance à une famille.
Durant les dernières décennies, ces lois ont considérablement évolué. Les enfants adoptés ont progressivement gagné les mêmes droits que les enfants dits « légitimes », quelles que soient les circonstances de leur adoption.
Cette recherche récente fait suite à une publication précédente sur la reconnaissance légale de l’appartenance à plusieurs familles[1] (la pluriparentalité). Cette fois-ci, c’est l’adoption intrafamiliale (au sein d’une même famille) qui intéresse les chercheures. Au travers d’une analyse d’archives de dossiers judiciaires dans le district de Saint-François, elles remontent le cours de l’histoire de l’adoption jusque dans les années 1950.
Trois grandes périodes ont dessiné les contours de la famille légale et des droits de l’enfant.
Illégitimes et abandonnés (1924 – 1960)
En 1924, l’adoption fait son apparition dans les textes de loi.
À l’époque, l’Église catholique a une forte influence sur les mœurs des populations. Un enfant né en dehors des liens du mariage est alors considéré comme illégitime et n’appartient pas juridiquement à sa famille. Puisque l’État n’offre aucun soutien aux mères célibataires, la grande majorité des jeunes filles confiaient leurs enfants illégitimes à l’adoption[2]. Ils étaient placés dans des crèches, tenues par des communautés religieuses, puis transférés dans des orphelinats s’ils n’étaient pas adoptés avant l’âge de six ans.
Dès 1939, il devient possible de faire adopter son enfant par un membre de sa famille, ou même d’adopter son propre enfant, pour le faire sortir de l’illégitimité (après s’être mariés, par exemple). Pourtant, jusqu’à la fin des années 1950, ces adoptions intrafamiliales sont rares. Les auteurs soulignent : « si l’on transgresse souvent l’interdiction religieuse d’avoir des relations sexuelles hors mariage, l’obligation d’abandonner à la crèche l’enfant illégitime est encore très largement respectée ».
Vers l’égalité (1960 – 1980)
Au cours des années 1960 et 1970, la société québécoise se transforme en profondeur; on parle de « révolution tranquille ». L’Église, dorénavant séparée de l’État, perd de son influence.
Les mères célibataires obtiennent l’accès à l’aide sociale et, en 1968, une loi fédérale rend le divorce accessible partout au Canada. Les crèches et la plupart des orphelinats ferment leurs portes. Les unions libres et la monoparentalité sont en hausse.
Si un enfant est adopté, les liens de filiation avec ses parents naturels sont officiellement rompus, même s’il est adopté par un membre de la famille, comme les grands-parents. C’est ce qu’on appelle l’adoption plénière. Le dossier de l’enfant devient confidentiel, il n’a plus accès aux documents le concernant, antérieurs à l’adoption. Une seule exception : le cas d’un enfant adopté par le nouveau conjoint de l’un de ses parents. Le lien au parent naturel demeure inscrit sur son nouvel acte de naissance. Il s’agit de la seule possibilité reconnue de « pluriparentalité ». Dans tous les cas, l’enfant adopté devient légitime et dispose des mêmes droits qu’un enfant né dans le mariage.
À la suite de ces changements, les adoptions intrafamiliales augmentent dans le district de Saint-François : le nombre triple en une dizaine d’années.
Ruptures familiales (1982 – 2014)
À partir des années 1980, « toute personne peut adopter, seule ou conjointement »[3]. Il n’est plus possible d’adopter son propre enfant, puisque la notion d’illégitimité a disparu des textes et que le statut conjugal n’a plus d’influence sur la filiation.
Chaque enfant ne peut avoir qu’un seul père et qu’une seule mère. Les enfants adoptés par le nouveau conjoint d’un parent perdent leur lien de filiation initial, malgré les recommandations formulées par l’Office de révision du Code civil.
Ce sont pourtant les cas les plus fréquents parmi les adoptions intrafamiliales. D’après les auteures, il est très rare que le parent biologique consente à la rupture du lien avec son enfant. Mais il n’existe pas d’autre alternative pour faire reconnaître les droits du beau-parent qui élève cet enfant comme le sien. Malgré les potentielles séquelles psychologiques d’une telle rupture avec son parent naturel, la loi ne prévoit aucune mesure pour vérifier que l’adoption se fait dans l’intérêt de l’enfant.
Un père et une mère ?
L’absence d’alternative à l’adoption plénière soulève de grandes questions : la rupture complète des liens de filiation est-elle toujours la meilleure solution?
Les enfants adoptés ont parfois connu leur famille d’origine, vécu et tissé des liens d’attachement avec eux. C’est notamment le cas lors d’une adoption par de proches parents, ou par un nouveau conjoint. Ils sont obligés de changer d’état civil alors qu’ils restent au sein de la même famille.
Selon les auteurs, une forme d’adoption additive et donc de pluriparentalité aurait sa raison d’être dans le droit québécois. Le projet de réforme du régime d’adoption lancé en 2007, et qui s’est échelonné sur plusieurs années, est finalement « mort au feuilleton » en 2013.
Cette occasion ratée de permettre un cumul de filiations n’est pas sans rappeler les débats qui entourent l’adoption coutumière des peuples Inuits dans le nord du Québec. Tel que le décrit Decaluwe[4], les enfants Inuits sont nombreux à appartenir simultanément à plusieurs familles. Pourtant, leurs pratiques traditionnelles ne sont pas légalement reconnues par les autorités provinciales.
[1] Françoise-Romaine Ouellette et Carmen Lavallée, 2015, La réforme proposée du régime québécois de l’adoption et le rejet des parentés plurielles
[2] « 80 % à 85 % des filles-mères confient leur enfant à l’adoption entre les années 1920 et 1960 » Malouin, 1996
[3] Art. 546 du Code civil québécois
[4] Béatrice Decaluwe, Marie-Andrée Poirier et Gina Muckle, 2016, L’adoption coutumière chez les Inuit du Nunavik : ses spécificités et conséquences sur le développement de l’enfant