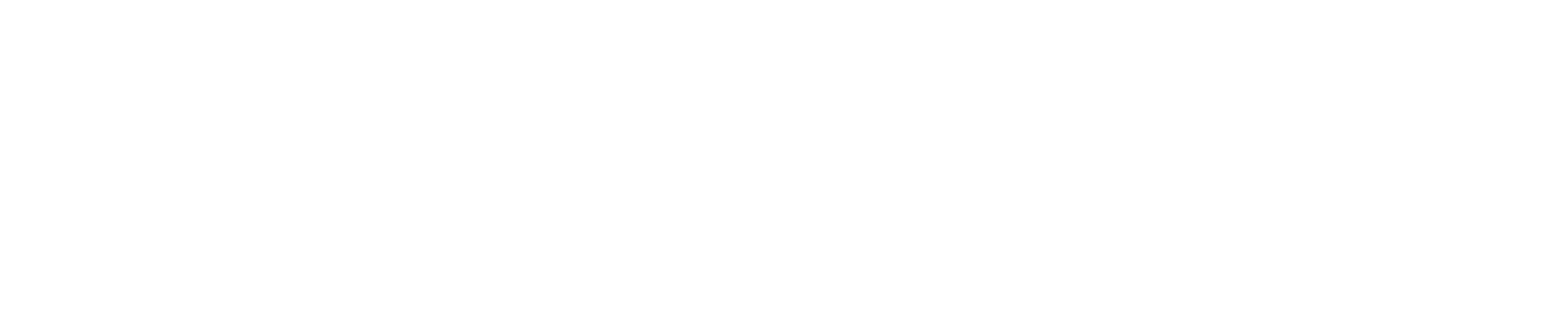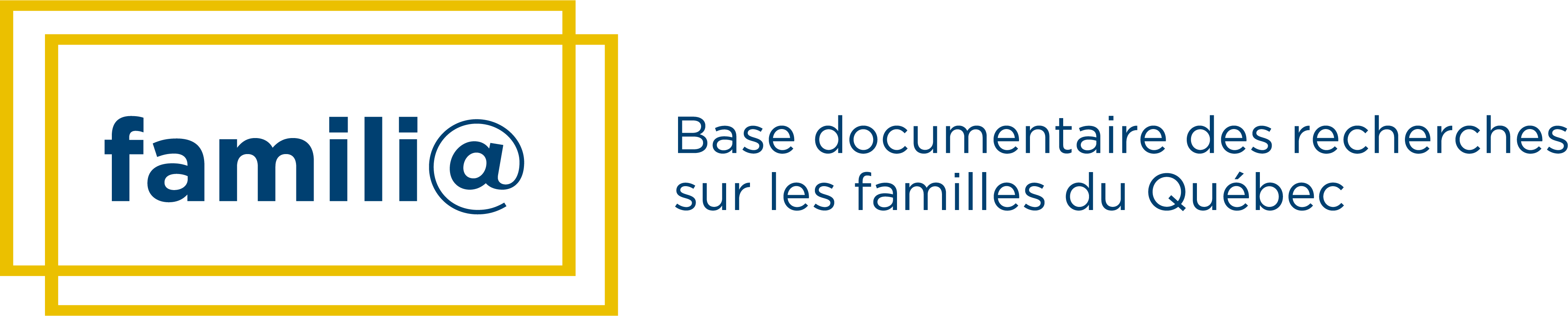« […] le lien [n’]est plus le même, il n’y a comme plus de lien je te dirais, oui il va tout le temps rester mon gars, oui je le veux avec moi, mais ce lien-là il faut que je le recrée […] »
Ces paroles sont celles de Luce, maman d’un petit bonhomme de 5 ans habitant avec papa et avec qui elle n’a plus de contact. À travers ses mots, l’affection de cette maman pour son enfant est perceptible, tout comme les défis qu’elle rencontre en lien avec son engagement parental. Comme plusieurs mères dont l’enfant est placé en famille d’accueil régulière ou banque mixte, dans la famille élargie ou chez l’autre parent, elle tente de négocier son rôle parental et sa place dans la vie de son petit garçon dans un contexte plein de défis.
Amélie de Serres-Lafontaine et Karine Poitras de l’Université du Québec à Trois-Rivières s‘intéressent à ce que les mères comme Luce ont à dire sur les facteurs facilitants ou entravants leur engagement parental en contexte de placement. Au total, elles réalisent onze entrevues auprès de neuf mères biologiques, soit une entrevue par enfant placé. Connues de la professeure Poitras, ces mères ont précédemment participé au tournant des années 2010 à un projet de recherche portant sur les contacts parents-enfants chez les parents d’origine dont l’enfant a vécu une situation de placement. Cette fois-ci, elles sont questionnées sur leur engagement parental auprès de leur enfant, toujours en contexte de placement. Trois éléments retiennent l’attention des chercheuses : la communication, la collaboration et la coexistence entre la mère, la famille accueillant l’enfant et le service de protection de la jeunesse.
Téléphone, carnet, en personne : l’important c’est de communiquer
Qui ne communique rien n’a rien! Tel pourrait être le dicton qui caractérise le mieux l’influence sur l’engagement parental de la communication avec la famille d’accueil ou avec l’enfant. À travers différentes stratégies, la famille d’accueil et la mère partagent les informations cruciales sur l’enfant, dont son développement, son milieu scolaire ou encore sa vie quotidienne.
« Donc nous autres on se communique beaucoup au contact, on a un cahier de communication, [la famille d’accueil] m’explique comment ç’a été pis moi j’explique ce qu’on a fait dans la journée pis si ç’a bien été […], s’il a fallu que j’intervienne beaucoup ou quoi. »
– Véronique, mère d’un enfant de 6 ans
À l’inverse, une communication conflictuelle ou inexistante empêche les mères d’exercer leur rôle parental. C’est d’ailleurs le cas de Marie, mère de deux enfants âgés de 10 et 11 ans, avec la famille qui a la garde de son deuxième enfant. Leur relation est tendue et l’absence de communication de la part de la famille nuit à l’engagement de la mère envers son enfant. Bien qu’il y ait absence d’une communication mère-enfant, les expressions non verbales, les anecdotes et les souvenirs racontés par les mères en entrevue révèlent l’attachement et l’engagement affectif envers leur enfant. Les mères affectionnent tout particulièrement la relation qu’elles entretiennent avec celui-ci; elles mentionnent leurs ressemblances ou les traits distinctifs de leur enfant. Pour survivre à la douleur émotionnelle et au vide laissé par leur absence, le deuil du lien avec l’enfant s’avère pour plusieurs un mécanisme de protection.
Pour celles ayant toujours un contact, la communication avec leur enfant renforce leur engagement affectif grâce à la proximité et au lien parent-enfant qu’elles développent. La relation qu’elles entretiennent avec leur enfant est un espace dans lequel elles peuvent exercer et entretenir leur maternité.
« Ah c’est l’fun, ouais, j’aime bien ça […] il a tout le temps de la jasette, il a tout le temps une histoire, une nouvelle à me raconter […]. »
– Jessica, mère d’un enfant de 5 ans
Par ailleurs, des actions concrètes dans le quotidien, par exemple assister aux rendez-vous de l’enfant, est aussi l’une des façons de manifester leur engagement parental.
Ensemble pour l’enfant : le pari de la collaboration
Une communication adéquate est-elle gage de succès? Oui, mais seulement s’il y a en plus une collaboration entre chacune des parties. En effet, le bien-être de l’enfant passe, entre autres, par une collaboration harmonieuse avec la famille accueillant l’enfant, le service de protection de la jeunesse et la mère biologique. Pour ce faire, la reconnaissance des bienfaits de chacun·e est primordiale. À leur façon, chaque adulte prodigue des soins ou enseigne des compétences à l’enfant qui lui permettra de surmonter les épreuves ou de s’épanouir tout au long de sa vie. En collaborant ensemble pour les besoins et les intérêts de l’enfant, l’entraide entre la famille d’accueil, le service de protection de la jeunesse et la mère biologique trace un avenir possible :
« Même que quand il allait en orthopédagogie ici à l’école – il avait des cours pour la lecture pis tout, il avait de la difficulté –, écoute, parfois je n’avais pas de transport… on s’appelait toujours la veille pis [la famille d’accueil de son premier enfant] me disait : ‘‘ As-tu un transport ? ’’ Là j’ai dit non, [la famille d’accueil] passait, me ramassait et on y allait ensemble, parce qu’elle sait que [enfant] tient beaucoup à ce que maman soit là. »
– Marie, mère de deux enfants de 10 et 11 ans
Pour d’autres, comme Jessica – mère d’un garçon âgé de 5 ans – c’est plutôt le soutien de la famille d’accueil par de petits gestes qui favorise son autonomie et son implication. Par exemple, la famille lui a demandé son autorisation pour inscrire l’enfant à un cours de hip-hop. Ces mères biologiques sentent que leurs opinions sont prises en considération lors des décisions concernant leur enfant.
Malheureusement, toutes les mères n’ont pas cette chance. Elles révèlent que certains milieux de vie compliquent ce processus, entre autres, en étant moins favorables à leur engagement parental. En effet, la visée adoptive de certains types de familles d’accueil encourage la compétition entre les parents et, parfois, l’exclusion des mères biologiques. Même son de cloche pour Josée – mère de deux enfants âgés de 8 et 10 ans placés chez les grands-parents – qui voit ses efforts parentaux être effacés par ses propres parents, et ce, malgré le lien de proximité. Blessée par l’absence de reconnaissance, par ses proches, des valeurs et des connaissances qu’elle transmet à son enfant, la maman tend à se retirer ou à perdre confiance en son habilité parentale.
Pour d’autres mères, la mise à l’écart par la famille d’accueil lors des prises de décisions sur les soins ou l’éducation de l’enfant, les motivent à se mobiliser pour être reconnues comme parent et pour participer à la vie de leur enfant. En revanche, elles font également face à des embuches institutionnelles. En effet, il n’est pas rare que leurs faits et gestes soient surveillés, et la ténacité de leur lien avec l’enfant mise à l’épreuve par le service de protection de la jeunesse. Manon – mère d’un enfant âgé de 8 ans – rapporte que les intervenant·e·s lui ont directement dit qu’il n’est pas souhaité que son enfant développe un lien avec elle. De son côté, Marie – mère de deux enfants âgés de 10 et 11 ans – raconte un incident dans lequel elle avait reçu la confirmation par la famille d’accueil qu’un·e intervenant·e était disponible pour sa rencontre supervisée avec son enfant. Le jour venu, le service de protection de la jeunesse annonce l’annulation de la rencontre, car aucun·e intervenant·e n’est libre. Elle reproche au service de protection de la jeunesse de pénaliser son enfant en l’empêchant de la voir.
Après une lutte acharnée, quelques-unes finissent par se désengager en raison de la fatigue et de la douleur émotionnelle vécues :
« [La famille d’accueil] était en accord avec moi à partir du moment où j’ai annoncé que je coupais les contacts. Là c’était très positif, elle avait une belle vision de moi, j’étais responsable […] Mais au moment où je me battais pour mes enfants, j’étais une sale trainée. »
– Sylvie, mère de deux enfants de 4 et 6 ans
Pourtant, de nombreuses mères mentionnent que la simple reconnaissance de leur parentalité par le service de la protection de la jeunesse et la collaboration harmonieuse avec la famille d’accueil favorise l’engagement parental et la coexistence des différentes figures parentales autour de l’enfant.
Coexister, la solution idéale
Une sortie avec la famille d’accueil, l’enfant et la famille recomposée de la mère : une situation utopique? Pas nécessairement. Marie – mère de deux enfants âgés de 10 et 11 ans – explique que le bon lien qu’elle entretient avec la famille d’accueil lui permet par exemple de faire une sortie à la piscine tous ensemble qui est à la fois agréable et amusante. Quand la relation avec la famille d’accueil est bienveillante, la coexistence devient une avenue prisée par tous et toutes. Elles favorisent un environnement sain dans lequel l’enfant peut se développer tout en limitant l’émergence de conflits d’attache que peut ressentir l’enfant vivant en famille d’accueil.
Reconnaissantes des soins apportés par les parents d’accueil et de leur présence dans la vie de leur enfant, les mères participant à l’étude les tiennent en grande estime. Certaines les considèrent même comme des parents à part entière pour leur enfant.
« [Quand] tu vas sortir de là à 18 ans, tu peux aller chez [ta famille d’accueil] même quand tu seras grand, [ta famille d’accueil] s’est occupée de toi et c’est comme [t]a mère un peu, [t]a deuxième maman, on considère ça comme ça […] »
– Marie, mère de deux enfants de 10 et 11 ans
Cette dernière met en lumière les différents niveaux d’engagement parental qui peuvent exister chez une même mère en fonction de la qualité de la communication et de la collaboration avec la famille qui accueille l’enfant. Marie admet que la relation avec la famille d’accueil de son premier enfant est à l’antipode de celle de son deuxième enfant. Elle n’appelle même plus son enfant, car c’est impossible de parler avec la famille. Par conséquent, son deuxième enfant est délaissé en raison de la relation conflictuelle avec la famille qui l’accueille, ce qui peut avoir un effet non négligeable sur son bien-être.
Déconstruire pour reconstruire : vers une parentalité partagée et adaptée?
En plus de mettre en doute leur légitimité parentale, le placement de l’enfant en famille d’accueil, chez la famille élargie ou chez l’autre parent est un événement déstabilisant pour les mères. Ces dernières passent alors par un processus de deuil ou de redéfinition de la parentalité qui nécessite un service d’accompagnement clinique et adapté à leur réalité. Or, l’établissement d’une coparentalité fonctionnelle en contexte de placement ne se limite pas aux efforts de la mère biologique. Il est crucial en tant qu’intervenant·e·s ou parent accueillant l’enfant de réfléchir à son propre impact sur l’engagement de la mère, mais, aussi, d’adopter une vision coparentale plutôt que de valoriser la présence d’un seul parent auprès de l’enfant. Ainsi, l’identification des conditions idéales favorisant l’engagement parental et la construction d’une coparentalité sont possibles. La communication, la collaboration et la coexistence avec la famille d’accueil, la famille élargie ou l’autre parent constituent les bases essentielles des interventions favorisant l’implication des mères dans le quotidien de leur enfant.