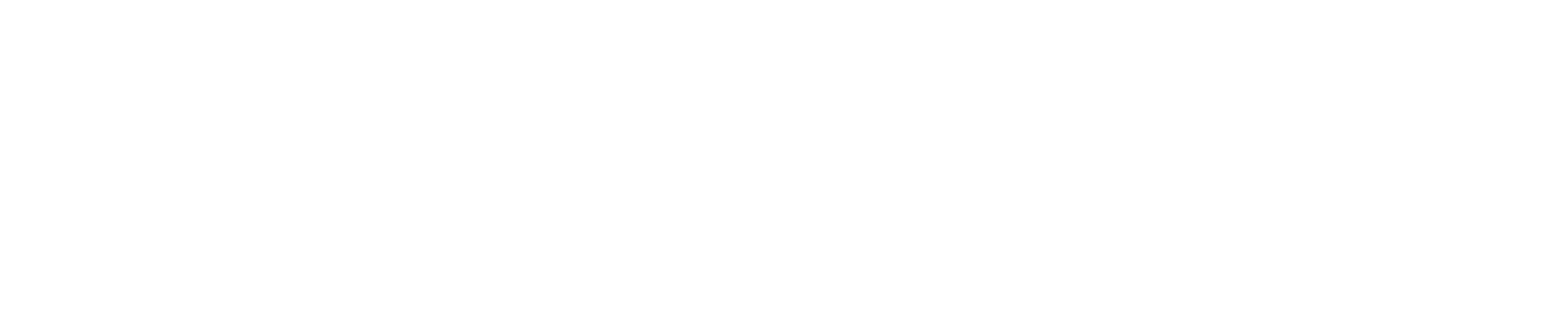Autonomie, confiance, égalité et respect mutuel : les valeurs de l’intervention en violence conjugale sont claires. Mais dans la pratique, c’est une autre paire de manches, les intervenantes font face à bien des dilemmes. De nombreuses femmes ne quittent pas la relation, retournent auprès d’un conjoint agressif, ou font des allers-retours avant de le quitter pour de bon. Comment les professionnelles assurent-elles le bien-être et la sécurité des victimes, tout en respectant leur autonomie ? Entre impuissance, peur et respect des choix de ces femmes, le quotidien des intervenantes est loin d’être un long fleuve tranquille.
L’étude des chercheures Célyne Lalande[1], Sonia Gauthier[2], Marie-Ève Bouthillier[3] et Lyse Montminy[4] met en lumière les choix éthiques difficiles que doivent faire les intervenantes auprès de femmes qui ne dénoncent pas les agressions commises par leur conjoint. Pour ce faire, elles recueillent les propos de 30 intervenantes psychosociales du Grand Montréal qui travaillent au quotidien auprès de femmes victimes de violence conjugale depuis au moins deux ans. Elles évoquent des situations quotidiennes où dilemme et désarroi s’entrecroisent, et les moyens utilisés pour les résoudre.
Insister pour dénoncer ?
Les intervenantes — bonne oreille des confidences des femmes — sont souvent tiraillées entre le respect des choix des victimes et la responsabilité de les aider. Mise en situation : une femme informe une intervenante des gestes violents de son conjoint à son égard. Problème fréquent : elle ne veut pas le signaler aux autorités. L’intervenante doit-elle inciter, même fortement, la femme à dénoncer ?
Tout un dilemme ! D’autant plus que chaque cas est unique. Pour résoudre le problème, l’intervenante prend notamment en compte le niveau de risque auquel s’expose la femme, son interprétation de la situation, la qualité de la relation qu’elle entretient avec elle, et la présence de preuves de la violence. En dépit de tous ces critères, il lui faut parfois faire appel à des collègues ou consulter le corps policier pour faire un choix.
Négocier la confidentialité ?
Si la femme demande à ce que l’information demeure confidentielle, l’intervenante fait de nouveau face à un choix cornélien : briser la confidentialité — et donc la confiance de la victime — pour que des mesures de sécurité soient mises en place, ou respecter sa volonté malgré le risque pour sa sécurité ?
D’un côté, protection, respect de la décision et droit à l’intégrité ; de l’autre, sécurité et maintien du dialogue. Décidément, beaucoup d’éléments pèsent dans la balance. Pour ne rien arranger, la décision de passer outre la confidentialité peut grandement altérer la relation entre la femme et l’intervenante. À ses yeux, on sacrifie sa confiance, le respect de son autonomie et de sa demande.
Si le lien de confiance est au cœur même de la relation thérapeutique, son maintien peut aussi faire courir de grands risques aux victimes. Est-ce que le « bon choix » existe vraiment ?
De nouveau, les intervenantes s’en remettent à l’évaluation du risque, tout en étant conscientes du fort degré d’incertitude. Des outils d’évaluation existent, mais aucun ne peut prédire les comportements futurs des auteurs de violence, et aucun ne peut remplacer le jugement clinique des intervenantes.
« Mais il faudrait vraiment que la dame soit vraiment à risque. Je pense qu’une notion de risque réel de vie ou de mort, là je pourrais risquer de perdre le lien de confiance pour essayer d’assurer sa vie. » (Intervenante CSSS interrogée)
Briser la confidentialité sans le dire ?
La résolution d’un dilemme entraîne la considération du suivant. Lorsque la violence est dénoncée aux autorités malgré l’entente de confidentialité, les intervenantes hésitent entre la transparence et le secret. Doivent-elles aviser la femme que des mesures de protection sont mises en place sans son accord ?
Bien souvent, même si l’exercice est délicat, les intervenantes favorisent la transparence. Ainsi, le but ultime consiste toujours à préserver le lien avec les femmes, et ce, malgré le désaccord. Au-delà du sentiment de « trahison » qu’elles peuvent éprouver, les intervenantes font aussi un pari risqué : elles ne peuvent être certaines que la dénonciation faite sans accord sera bénéfique pour la femme. Qui plus est, ces dernières mettront sûrement fin au suivi à cause du bris de confiance. À plus large perspective, elles peuvent aussi nier la violence qu’elles vivent et donc, ne pas obtenir l’appui du système judiciaire. Résultat : elles se retrouveront plus isolées qu’elles ne l’étaient déjà.
« Ça aussi c’est une situation qui est dure parce que la façon que la femme a réagi, ‘’Si j’avais su que vous l’auriez signalée, je ne serais jamais venue consulter ici ‘’. [O]n ne sait pas comment le conjoint violent va réagir. Est-ce que c’est le type qui va respecter la loi, respecter des conditions ? Madame est-ce qu’elle est prête à quitter la relation violente […] ? » (Intervenante en maison d’hébergement)
En revanche, les valeurs professionnelles des intervenantes telles que le maintien d’un lien de confiance, la position de tolérance, ainsi que la relation égalitaire valorisée par les approches féministes laisseraient une marge de manœuvre plus concrète pour soutenir ces femmes à plus long terme.
Comment les intervenantes gèrent-elles ces questionnements éprouvants ? Elles emploient la « rationalisation », c’est-à-dire l’acceptation de ce qu’elles ne peuvent contrôler, qui leur permet de tolérer la souffrance de l’autre et leur propre impuissance. De cette manière, elles arrivent à donner un sens à la décision de la femme.
Adapter l’intervention à la diversité des réalités
Les dilemmes éthiques quotidiens des intervenantes auprès de femmes victimes de violences conjugales sont complexes, et dévoilent les risques de leurs décisions.
Cela dit, qu’en est-il des défis de l’intervention psychosociale lorsqu’à la situation de violence se combinent d’autres enjeux, comme l’immigration, l’itinérance, les problèmes de santé mentale ? Comme le soulignent le Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale (2018-2023) et la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, les organismes qui offrent des services aux personnes touchées par la violence conjugale doivent s’adapter aux besoins et aux réalités de plusieurs groupes de la population. Ainsi, afin de répondre de manière plus adaptée et approfondie à leurs besoins, l’intervention auprès de femmes victimes de violence conjugale se doit non seulement d’être féministe, mais également d’intégrer la reconnaissance d’autres injustices sociales ou formes de discrimination.
[1] Professeure de travail social à l’Université du Québec en Outaouais
[2] Professeure à l’École de service social de l’Université de Montréal
[3] Professeure d’éthique clinique à l’Université de Montréal
[4] Professeure à l’École de service social de l’Université de Montréal