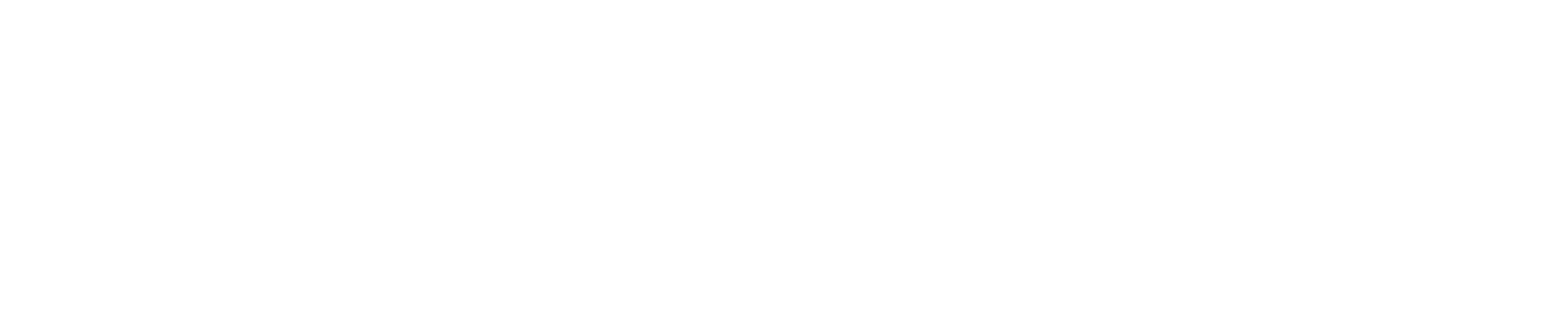Lors d’une séparation, le parent qui a la garde des enfants peut bénéficier d’une aide économique fournie par l’autre conjoint, une pension alimentaire pour enfant. Il en va, dit-on aujourd’hui, du bien-être de l’enfant. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au départ, la pension visait surtout à assurer le bien-être économique des mères monoparentales. Depuis son adoption, en 1997, le système de perception et de fixation des pensions alimentaires pour enfant a connu une importante évolution, marquée par les impératifs de l’État et par les droits des mères, des enfants, des parents et des pères. En fait, la logique qui l’a fait naître, qui plaçait la mère au cœur de l’enjeu, a graduellement disparu du discours public.
C’est ce que constatent trois chercheures de l’Université Laval, au terme d’une étude fondée sur plusieurs sources documentaires et sur des entrevues. Dans un premier temps, elles analysent les écrits scientifiques publiés depuis les années 1990. Ensuite, elles passent au peigne fin la documentation publiée par trois catégories d’acteurs : les groupes de la société civile (associations, groupes de femmes, de pères), les partis politiques et les organismes publics (ministères, organismes parapublics). Pour finir, elles récoltent les témoignages de 32 responsables faisant partie de ces trois catégories d’acteurs (militants, politiciens, ex-politiciens, ex-députés, ex-ministres).
Répondre à la pauvreté des mères et des enfants
Les années 1970-80 sont témoins d’une hausse marquée du nombre de divorces chez les couples québécois, entraînant trop souvent un appauvrissement des mères. Différents groupes de femmes et organisations féministes dénoncent alors les réalités quotidiennes de ces mères monoparentales fortement touchées par la précarité financière. À l’époque, l’accès à une pension alimentaire pour enfants est particulièrement difficile; il n’existe ni barème pour en fixer les montants ni mécanismes pour s’assurer le conjoint verse bel et bien la pension. Résultat : plusieurs mères monoparentales ne reçoivent pas d’argent de leur ex-conjoint et peinent à joindre les deux bouts.
L’État québécois, responsable d’assurer le bien-être minimal de ses citoyens, et donc de ces femmes, se retrouve alors avec une charge supplémentaire. Comme le rappellent les auteures, l’État « évoque le lourd fardeau imposé aux programmes d’aide sociale par ces pensions impayées ». Le hic? Cette responsabilité financière entre en contradiction avec le nouvel impératif du gouvernement pendant les années 1980-90 : réduire les dépenses publiques. En effet, le modèle de l’État providence s’essouffle. Il y a donc un avantage, pour le gouvernement, à ce que les pensions alimentaires soient dûment payées par le conjoint. Comme le souligne un fonctionnaire rencontré par les chercheuses : l’idée d’un régime de perception et de fixation, qui germe depuis longtemps, compte maintenant un appui de taille : celui de l’État. Cet appuie se traduit par une révision du régime de gestion des pensions alimentaires pour enfants, notamment par une défiscalisation des pensions. Ce faisant, le montant n’est plus imposé pour le parent qui reçoit l’argent ni déductible pour celui qui le verse.
Qui dit mère, dit enfant
Pour les différents groupes de femmes et groupes militants de l’époque, la création du régime de perception des pensions alimentaires pour enfant répond à un besoin criant : sortir les mères monoparentales de la précarité financière et, du même coup, assurer le bien-être des enfants. Comme le rappellent les auteures, pour les acteurs du moment, l’intérêt et le bien-être de l’enfant passent par le bien-être de sa mère : « [a]dopter des politiques en faveur des mères, c’est servir les intérêts des enfants […]. » Jusqu’au tournant des années 2000, l’intérêt de l’enfant et le bien-être de la mère sont indissociables.
L’intérêt de l’enfant : un concept qui gagne en crédibilité
Le concept du droit de l’enfant gagne en popularité au cours des années 1980, un phénomène qui n’est pas unique au Québec. En effet, suite à l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant (1979), plusieurs pays membres de l’ONU utilisent de plus en plus fréquemment le concept d’«intérêt de l’enfant» dans plusieurs sphères du droit. Pendant les années 1990, la société civile québécoise, encouragée par plusieurs experts en prévention précoce, fait de même et tient de plus en plus compte de l’intérêt de l’enfant en matière de droit. Comme l’écrivent les auteures, « [l’intérêt de l’enfant] s’est progressivement dissocié de l’impératif de redressement de la situation économique des mères monoparentales pour devenir une fin en soi. » En d’autres mots : le bien-être des enfants ne passe plus nécessairement par celui des mères. Par contre, encore aujourd’hui, le concept d’intérêt de l’enfant n’est pas clairement défini par le Code civil du Québec, ce qui peut causer problème dans les cas de violence conjugale.
Le renouveau de la paternité et la naissance du « parent »
Le concept de l’intérêt de l’enfant gagne en crédibilité. Cette transformation coïncide aussi avec une hausse des revendications de différents groupes de pères qui ne veulent plus être perçus comme de simples pourvoyeurs et qui revendiquent donc une valorisation de leur rôle.
Le renouvellement de la paternité se conjugue avec la popularité grandissante de la formule de garde partagée, qui passe de 8,1 % des ordonnances de la Cour en 1998, à 19,7 % dix ans plus tard. La justice privilégie de plus en plus ce mode de garde. Fait important : la garde partagée « permet une réduction de la pension alimentaire pour enfant lorsque le parent non gardien s’occupe de l’enfant entre 20 et 40 % du temps annuel. » Les pères ont donc aussi un intérêt économique à accepter la garde partagée.
Et l’enfant dans tout ça? Les spécialistes s’entendent pour dire que son bien-être passe par la fréquentation de ses deux parents, sauf dans des cas de violence conjugale. Le concept d’intérêt de l’enfant prend le pas sur les notions de « mère » et de « père », qui deviennent chacun un simple « parent », sans distinction père-mère. Comme le résument les auteures, « l’indifférenciation entre les parents est désormais la norme ».
De la condition des mères
L’intérêt de l’enfant se retrouve donc au centre de l’évolution du régime des pensions alimentaires pour enfant. Comme le mentionnent les auteures, les pères y trouvent aussi leur compte : ils ont réussi « à faire valoir leur rôle affectif et relationnel auprès des enfants » et peuvent, dans plusieurs cas, bénéficier d’une réduction de la pension à verser à l’ex-conjointe. Mais encore : les responsabilités parentales en garde partagée sont-elles distribuées équitablement? Qui s’occupe, par exemple, des rendez-vous chez le dentiste ou le pédiatre, de faire les démarches pour trouver un CPE, de magasiner les vêtements? Chez les couples québécois ce sont les femmes qui accomplissent encore la plus grande part de ce travail invisible. Si la situation est telle dans un contexte de garde partagée, les montants versés devraient-ils en tenir compte?